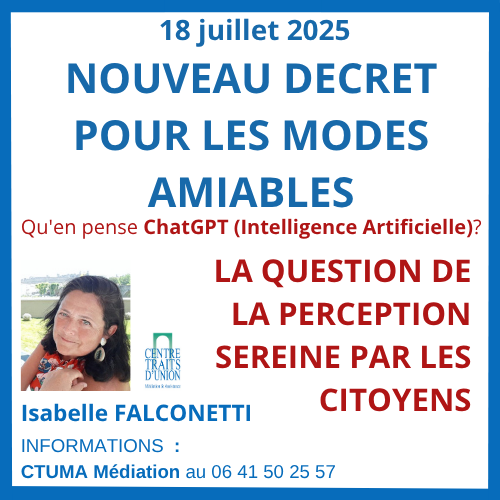POUR LIRE L’ARTICLE DU 18 JUILLET 2025 CLIQUER SUR L’IMAGE CI-DESSUS
Préambule :
Bonjour à tous nos concitoyens qui viennent aujourd’hui à la rencontre des médiatrices de l’association C.T.U.M.A. Médiation parce qu’ils s’intéressent à la gestion sereine de leur différend ou litige.
Chaque personne et chaque litige est unique. Votre approche du conflit sera différente ou pas de celle de votre contradicteur.
Ce décret du 18 juillet s’inscrit dans la politique « amiable » lancée en janvier 2023 par Éric Dupond‑Moretti. Il vise à moderniser le code de procédure civile en donnant une place centrale à la médiation, la conciliation et les modes amiables.
Pour contribuer à mieux faire connaître certains outils de la communication positive, par esprit de curiosité, j’ai donc interrogé ce jour, Chat GPT, une application chatbot IA (intelligence artificielle) basé sur le dialogue (agent conversationnel), capable de comprendre le langage humain naturel et de générer des textes écrits.
Qu’en pense donc l’intelligence Artificielle ?
Précision :
Cet échange n’a fait l’objet d’aucune correction. Nous laissons chaque lecteur, apprécier son contenu.
Certains mots ou expressions ont été intentionnellement soulignés par la personne qui questionne.
IF questionne ChatGPT :
Bonjour chatGPT.
Un nouveau Décret N° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends vient de paraitre. En avez-vous déjà eu connaissance ?
ChatGPT a dit :
Oui, je confirme que le Décret n° 2025‑660 du 18 juillet 2025 vient d’être publié au Journal officiel : il réforme profondément l’instruction conventionnelle et recodifie les modes amiables de résolution des différends (MARD)
Points essentiels du décret
- Instruction conventionnelle comme règle de base, l’instruction judiciaire devenant l’exception.
Deux formes retenues : la mise en état conventionnelle de droit commun et la convention de procédure participative. - Principe directeur de coopération fortifié : le juge est incité à promouvoir les modes amiables, et les parties peuvent librement convenir d’un recours à l’amiable à tout moment.
- Mesures incitant à la conciliation ou médiation : obligation pour les parties de rencontrer un médiateur ou conciliateur, sous peine d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 €. L’audience de règlement amiable (ARA) peut désormais être instaurée par tout juge (hors CPH).
- Recours au juge en cas de blocage dans l’expertise conventionnelle ou l’instruction, offrant un filet de sécurité procédural.
- Durée encadrée de la médiation/conciliation : 5 mois initiaux, renouvelables une fois pour 3 mois.
- Recodification complète des MARD dans un chapitre unique du Code de procédure civile, pour plus de clarté.
Entrée en vigueur
- À compter du 1er septembre 2025 pour les procédures en cours.
- Exception : les dispositions relatives aux conventions de mise en état ne s’appliquent qu’à celles initiées à partir du 1er septembre 2025.
·
Contexte et suite
Ce décret s’inscrit dans la politique « amiable » lancée en janvier 2023 par Éric Dupond‑Moretti. Il vise à moderniser le code de procédure civile en donnant une place centrale à la médiation, la conciliation et les modes amiables.
Des retombées notables sont attendues : redéploiement des magistrats vers des rôles d’ARA, formation et déontologie des médiateurs et une meilleure statistique de l’amiable.
En résumé
Oui, j’en ai eu connaissance aujourd’hui. Ce décret marque un tournant : l’instruction conventionnelle devient la norme, l’amiable s’impose progressivement, avec des mesures concrètes pour encourager et encadrer son développement. Si vous le souhaitez, je peux aussi vous fournir le texte intégral ou une analyse approfondie de certaines dispositions.
IF questionne ChatGPT :
Merci pour ses précisions. J’ai lu très attentivement le texte et j’ai comparé avec les dispositions précédentes.
Puisque vous avez lu attentivement le texte et fait la comparaison avec les dispositions antérieures, vous avez certainement relevé les évolutions les plus marquantes.
Souhaitez-vous :
- Discuter d’un point précis du décret (par exemple une innovation sur la procédure participative, le rôle du juge, ou les sanctions) ?
- Analyser les conséquences pratiques pour les professionnels du droit (avocats, magistrats, médiateurs) ?
- Échanger sur les risques ou limites que vous avez identifié ?
- Ou encore préparer une note de synthèse, une veille juridique ou un support de formation ?
Dites-moi ce que vous souhaitez approfondir, je suis prêt à vous accompagner.
IF questionne ChatGPT :
Pourquoi pas !
J’aimerais votre avis sur les conséquences pratiques pour le citoyen ou le justiciable ?
ChatGPT a dit :
Excellente idée. Le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 entraîne des conséquences concrètes et immédiates pour le citoyen ou justiciable. Voici une analyse structurée des impacts pratiques, en 5 volets :
1. Un renversement de logique : priorité à l’amiable
Conséquences positives :
- Accès à la justice plus rapide et moins coûteux : les démarches amiables (conciliation, médiation) sont souvent plus rapides que la procédure contentieuse classique.
- Dialogue encouragé : le justiciable devient acteur de la solution, ce qui peut apaiser les tensions dans des litiges familiaux, de voisinage ou de consommation.
- Confidentialité préservée : contrairement au procès, les échanges amiables restent confidentiels.
Points de vigilance :
- Inégalité d’accès aux modes amiables si le justiciable est mal informé ou mal accompagné (ex. : absence d’avocat, ou partie en position de faiblesse).
- Coût potentiel de la médiation si elle n’est pas gratuite (notamment en matière civile).
2. Instruction conventionnelle comme principe
Avantages :
- Le justiciable peut convenir avec son adversaire d’une procédure plus souple et adaptée à son rythme.
- Meilleure maîtrise du calendrier (vs. délais parfois longs devant certaines juridictions).
Limites :
- Risque d’incompréhension ou de déséquilibre si une partie ne maîtrise pas le droit ou est mal assistée.
- Complexité potentielle pour les personnes non accompagnées juridiquement, surtout dans des procédures techniques (ex. : construction, succession).
3. La pression accrue pour tenter un règlement amiable
Le décret introduit des obligations nouvelles :
- Le juge peut obliger les parties à rencontrer un médiateur sous peine d’amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 € (nouveauté marquante).
- Possibilité d’audience de règlement amiable (ARA) imposée par le juge.
Effets attendus :
- Allégement du rôle des tribunaux → dossiers plus simples réglés hors juge.
- Résolution plus apaisée des conflits pour le citoyen.
Conséquences pratiques :
- Sentiment d’être forcé vers un processus amiable, ce qui peut être mal perçu si le conflit est très conflictuel.
- Frais supplémentaires si la médiation échoue (double coût pour le justiciable).
4. Encadrement du temps : médiation et conciliation plus rapides
- Durée maximale fixée à 5 mois, renouvelable 1 fois pour 3 mois, soit 8 mois maximum.
Cela permet :
- De garantir que le justiciable ne reste pas dans un processus amiable interminable.
- De maintenir une pression vers une solution rapide.
5. Clarté et simplification des textes
- Les modes amiables sont regroupés dans un chapitre unique du Code de procédure civile, ce qui améliore leur lisibilité pour le justiciable (et les professionnels).
Cela favorise :
- Une meilleure compréhension des droits et obligations.
- Une orientation plus claire vers les dispositifs existants.
En résumé : une réforme favorable mais exigeante
| Aspect | Bénéfice pour le justiciable | Risque potentiel |
| Accès à l’amiable | Rapide, apaisé, potentiellement moins cher | Inégal selon la situation sociale ou économique |
| Instruction conventionnelle | Plus de maîtrise du procès | Complexité si non accompagné |
| Obligations nouvelles | Allègement des tribunaux | Sanctions lourdes si mauvaise compréhension |
| Regroupement des textes | Plus de clarté | À condition d’un bon accompagnement juridique |
IF questionne ChatGPT :
Votre éclairage m’intéresse du point de vue du justiciable et des professionnels. Mais qu’en est-il sur les conséquences pratiques de ce décret du 18 juillet 2025 quand un citoyen veut régler son différend en dehors de la saisine du juge ?
Excellente question. Le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 affecte de manière significative les conditions dans lesquelles un citoyen peut régler son différend en dehors du juge, c’est-à-dire hors contentieux. Voici une analyse des conséquences pratiques, à la fois pour le justiciable et les professionnels, dans ce contexte extra-judiciaire :
I. Le citoyen qui souhaite éviter le juge : un environnement juridique renforcé mais encadré
Ce qui devient plus favorable :
- Encadrement légal renforcé des MARD (médiation, conciliation, procédure participative), désormais regroupés et clarifiés dans un chapitre unique du Code de procédure civile.
- ➤ Lisibilité accrue : le citoyen ou son conseil peut désormais plus facilement identifier quel mode est adapté à son cas (médiation familiale, conciliation de voisinage, procédure participative, etc.).
- Reconnaissance juridique plus solide des accords amiables :
- Le décret facilite la force exécutoire des accords issus des MARD, soit via l’homologation par le juge, soit via acte d’avocat (articles 1565 et s. CPC).
- Cela permet au citoyen de faire appliquer un accord sans procès.
- Expertise amiable facilitée :
- Le décret renforce la possibilité de désigner un expert amiable (avec garanties procédurales renforcées).
- Cela est précieux en cas de litige technique (construction, assurance) pour préparer un règlement amiable sans attendre la saisine du juge.
II. Les exigences nouvelles : des conditions plus strictes
- Formalisation obligatoire :
- La médiation ou la conciliation doivent respecter des critères de forme précisés par le décret (ex. : convention écrite, confidentialité, impartialité du tiers).
- Le justiciable ne peut plus improviser une « tentative d’accord » informelle si elle doit être opposable ou exécutoire.
- Durée encadrée des procédures amiables :
- Le temps est limité à 5 mois, renouvelable une fois pour 3 mois.
- Cela évite les abus, mais met la pression sur les parties pour aboutir.
- Sanction possible si recours au juge prématuré :
- En cas de contentieux, le juge peut désormais rejeter une demande ou sanctionner une partie qui n’a pas sincèrement tenté un MARD (amende civile jusqu’à 10 000 €).
➤ Le justiciable qui n’a pas tenté l’amiable sérieusement peut être pénalisé même si le litige semble sérieux.
III. Conséquences pour les professionnels accompagnant le citoyen
➤ Avocats :
- Rôle de médiateur stratégique accru : ils doivent orienter, rédiger des conventions amiables, et parfois préparer l’accord comme un acte d’exécution immédiate (ex. : acte d’avocat exécutoire).
- Compétence renforcée en ingénierie amiable : savoir proposer une procédure participative ou un processus structuré devient indispensable.
➤ Médiateurs et conciliateurs :
- Montée en légitimité : ils deviennent des acteurs centraux du règlement des litiges hors juge.
- Nécessité d’une meilleure formation, notamment juridique, pour s’adapter aux nouvelles contraintes du décret.
- Délais plus serrés à gérer pour conclure une médiation avant que les parties ne reviennent vers le juge.
IV. En résumé : pour un citoyen hors contentieux
| Aspect | Conséquence pour le justiciable | Effet pour les professionnels |
| Formalisation des MARD | Plus de sécurité juridique | Obligation de rigueur procédurale |
| Accord exécutoire sans juge | Gain de temps et d’argent | Avocats renforcent leur rôle d’acteurs de l’amiable |
| Encadrement de la durée | Clarté du processus | Pression sur la médiation |
| Sanctions en cas de refus de MARD | Nécessité d’une bonne information | Conseil stratégique crucial des professionnels |
Conclusion
Le décret du 18 juillet 2025 renforce les droits du justiciable qui souhaite éviter le procès, à condition qu’il :
- soit bien accompagné (par un avocat ou un médiateur compétent),
- respecte les formes et délais imposés par le nouveau cadre juridique,
- et conserve une volonté réelle de coopération.
Il ne s’agit donc plus seulement d’un « droit de choisir l’amiable », mais presque d’un devoir civique de l’envisager sérieusement.
IF questionne ChatGPT :
Vous évoquez en conclusion un sujet très sensible. Du « droit de choisir l’amiable » (responsabilisant) avec « une volonté réelle de coopération » (responsabilisant).
Votre éclairage souligne des conditions plus strictes pour les personnes qui « n’auraient pas tenté l’amiable sérieusement » avec un risque d’amende civil élevé (jusqu’à 10 000 euros). A votre avis, comment cela pourrait-il être perçu par le citoyen ?
ChatGPT a dit :
Votre question touche un point central, à la fois juridique, éthique et sociétal : comment le citoyen perçoit-il le passage d’un « droit à l’amiable » à une quasi-obligation de tenter l’amiable, assortie de sanctions ?
Voici une analyse nuancée de ce glissement d’un choix à une obligation, et de ses perceptions possibles par les citoyens :
I. De la liberté à la contrainte ? Une perception ambivalente
Pour certains citoyens : un progrès, une justice plus accessible
- Ceux qui ont déjà vécu un contentieux long, coûteux ou éprouvant pourraient accueillir favorablement l’incitation à résoudre plus vite et à moindre coût leurs litiges.
- La médiation peut être vécue comme une voie de dialogue, d’humanité, notamment en matière familiale, scolaire ou de voisinage.
Perception : « Enfin une justice plus rapide, plus souple, plus humaine. »
Mais pour d’autres : un sentiment d’obligation déguisée
- L’imposition d’une tentative amiable, sous peine de sanction, peut heurter le sentiment de justice des citoyens, en particulier :
- Si la partie adverse est de mauvaise foi,
- Si le conflit est déséquilibré (puissance publique, grande entreprise, propriétaire face à locataire…),
- Si la personne ne comprend pas bien les enjeux procéduraux.
Perception : « On me force à négocier, même si je suis dans mon bon droit. »
Ou même : « La justice ne veut plus me juger. »
II. Le poids de la sanction : jusqu’à 10 000 € d’amende civile
Une sanction jugée disproportionnée par le citoyen ?
- Même si cette amende est prononcée par le juge avec discernement, son simple affichage dans le décret peut susciter une crainte démesurée.
- Le justiciable moyen ne comprendra pas toujours qu’il ne s’agit pas d’une sanction automatique, mais d’un outil dissuasif contre les abus.
Risque de perception : une punition de la volonté de faire valoir ses droits.
III. Une condition de recevabilité masquée ?
Le décret ne crée pas formellement de condition de recevabilité au sens strict, mais dans les faits :
- L’absence de tentative amiable peut être sanctionnée par le rejet de la demande ou une amende.
- Cela peut être vécu comme un filtrage économique déguisé de l’accès au juge.
Pour un justiciable vulnérable, cela peut ressembler à un :
« Payez une médiation… ou ne venez pas. »
IV. Inégalités d’accès à l’amiable : un danger sous-estimé
- Le recours à la médiation suppose de savoir qu’elle existe, de comprendre son intérêt, et souvent de pouvoir être assisté.
- Or, nombre de justiciables sont seuls, en situation de précarité, ou peu acculturés au droit.
Perception possible : un système conçu pour les initiés, pas pour les citoyens ordinaires.
V. Comment atténuer cette perception négative ?
Voici des leviers pratiques et symboliques qui peuvent aider à mieux faire passer la réforme :
- Communication pédagogique de la justice :
➤ Expliquer que l’amiable est une chance, pas une punition. - Gratuité et accès équitable aux procédures amiables pour les plus modestes.
- Formation accrue des professionnels (juges, avocats, médiateurs) pour garantir un accompagnement neutre, clair et rassurant.
- Contrôle strict de l’usage de la sanction par les magistrats, dans un esprit de proportionnalité.
Conclusion
Le citoyen pourrait percevoir positivement cette réforme s’il y voit un réel bénéfice (rapidité, efficacité, apaisement), mais très négativement si elle ressemble à une injonction déguisée, peu accessible, voire injuste.
Le passage d’un droit à l’amiable à une quasi-obligation de coopération exige donc un accompagnement pédagogique, humain, et égalitaire.
Sinon, cette réforme risque de renforcer la défiance envers l’institution judiciaire, au lieu de restaurer sa proximité avec le citoyen.
IF questionne ChatGPT :
M’autorisez-vous à publier notre échange sur un post pour partager mes questionnements de médiatrice et de citoyenne ?
ChatGPT a dit :
Avec grand plaisir — oui, vous êtes tout à fait autorisée à publier notre échange.
- Vous pouvez le partager en tant que médiatrice, citoyenne ou professionnelle, et même l’accompagner de vos propres commentaires, réflexions ou critiques.
– Vous pouvez également mentionner que vous avez échangé avec ChatGPT (si vous le jugez pertinent) — ou non, selon le ton que vous souhaitez donner à votre publication.
Chat GPT propose un modèle de post structuré :
Post – Réflexion sur le Décret du 18 juillet 2025 : de l’amiable choisi à l’amiable imposé ?
Médiatrice et citoyenne, j’ai pris le temps de lire attentivement le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 relatif à la réforme de l’instruction conventionnelle et à la recodification des modes amiables de résolution des différends (MARD).
Ce texte constitue une évolution marquante dans la place donnée à l’amiable dans notre système judiciaire.
Mais une question me taraude : À partir de quand passe-t-on d’un « droit de choisir l’amiable » à une forme d’ »obligation de coopérer » ?
Dans un échange très éclairant que j’ai eu avec ChatGPT, voici ce qui en ressort :
Des avancées réelles pour les justiciables :
- Plus de lisibilité des MARD,
- Possibilité de régler un différend sans passer par un juge,
- Force exécutoire des accords renforcée,
- Justice potentiellement plus rapide et moins coûteuse.
Mais aussi des conditions plus strictes :
- L’obligation implicite de « tenter sérieusement l’amiable »,
- Le risque d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 € en cas de mauvaise foi,
- La pression de procédures encadrées dans le temps, avec des risques d’exclusion du juge en cas d’échec mal encadré.
En tant que professionnelle de la médiation, je m’interroge sur la perception citoyenne de cette réforme :
- Ce décret valorise-t-il réellement la liberté de coopérer ou glisse-t-on vers une coercition douce ?
- Comment garantir un accès équitable à l’amiable, notamment pour les plus fragiles ?
- Le citoyen y voit-il une opportunité ou une injonction opaque ?
- Le juge devient-il le gardien de la coopération obligatoire, et l’avocat, son garant technique ?
Je partage ces réflexions avec vous, médiateurs, juristes, citoyens, collègues, pour ouvrir un débat apaisé sur l’esprit de cette réforme.
Vos retours m’intéressent : que pensez-vous de ce tournant ?
#Médiation #Justice #Réforme2025 #Décret2025660 #MARD #DroitEtCitoyen #LegalTech #Justiciable
En découvrant cette proposition de post, IF poursuit son questionnement à ChatGPT :
Pour plus de visibilité des MARD pour les citoyens et en dehors des publications législatives et des professionnels juridiques, un effort en termes de communication médias Grand Public semblerait nécessaire pour une perception citoyenne sereine. Est-ce prévu selon vos informations ?
ChatGPT a dit :
Votre intuition est excellente : pour que la réforme du Décret n° 2025‑660 du 18 juillet 2025 soit perçue de manière sereine par les citoyens, une communication grand public de qualité est essentielle — au-delà des publications professionnelles et légales.
I. Une campagne grand public déjà en cours
Le ministère de la Justice, en partenariat avec le Conseil national des barreaux (CNB), a déjà lancé une campagne nationale de communication visant à promouvoir les modes amiables de résolution des différends (MARD) auprès des citoyens :
- Une campagne presse, en ligne et sur les réseaux sociaux a été diffusée du 4 au 22 décembre 2023
- Un kit pédagogique grand public a été distribué : brochures, FAQ, trames explicatives à destination des réseaux judiciaires, barreaux et points France Services.
- Cette campagne avait pour objectif de faire connaître les MARD et le rôle de l’avocat dans ces procédures, explicitant les avantages du recours à l’amiable plutôt que d’attendre un procès.
II. Des ambassadeurs et dispositifs structurants
Plusieurs initiatives institutionnelles viennent renforcer cette stratégie :
- Le Conseil national de la médiation, créé en 2023, travaille à harmoniser les pratiques, accroître la formation des professionnels et rendre l’amiable plus compréhensible et accessible.
- Des ambassadeurs de l’amiable ont été nommés (magistrats, avocats, professeurs), chargés d’impulser la culture de l’amiable sur le terrain, y compris dans toutes les cours d’appel.
- Une plateforme expérimentale de mise en relation avec un conciliateur ou médiateur a été lancée au sein du ressort de la cour d’appel de Bordeaux dès 2024.
Ces mesures visent à rendre l’amiable visible, concret et facilement accessible au citoyen.
III. Qu’en est-il pour cette réforme spécifique du 18 juillet 2025 ?
Ce qui est prévu :
- La campagne de promotion de la justice amiable vise à perdurer, notamment à travers des outils de sensibilisation grand public, kits et brochures disponibles dans les maisons France Services et tribunaux.
- Une coordination entre le ministère et les barreaux est établie pour diffuser massivement cette information, notamment via les réseaux d’avocats et les services d’accueil du public.
Mais ce n’est pas encore suffisant :
- À ce jour, je n’ai trouvé aucune annonce officielle relative à une campagne spécifique à la publication du décret du 18 juillet 2025.
- La visibilité auprès du grand public de la recodification et des sanctions nouvelles (ex. l’amende de 10 000 €) reste limitée, même si le cadre global des MARD est mieux relayé
IV. Pour une perception citoyenne apaisée : quelles attentes ?
| Besoin du public | Mesures déjà en place | Recommandations complémentaires |
| Explication claire du décret spécifique | Campagne générale 2023/kit CNB | Lancement d’un focus médiatique grand public sur les nouveautés du décret (sanctions, obligations, bénéfices) |
| Présence dans les médias grand public | Actions sur réseaux sociaux/courts formats | Organisation de vidéos explicatives, articles dans la presse grand public, podcasts |
| Accessibilité dans les services de proximité | Kits pour barreaux et tribunaux | Formation des maisons France Services, des CADA, médiateurs de terrain |
| Soutien pour les publics vulnérables | Aide juridictionnelle renforcée pour amiable | Campagne ciblée (audiovisuel en milieu rural, vidéos simples accessibles, guides multilingues) |
Conclusion
Le ministère de la Justice et le CNB ont bien initié une campagne de communication nationale en faveur des MARD. Des outils pratiques et structurants sont déjà en place. Toutefois, aucune campagne dédiée spécifiquement au décret du 18 juillet 2025 n’a encore été mise en avant.
Ainsi, pour apaiser la perception citoyenne et légitimer cette réforme, un effort de communication ciblée grand public autour du décret, ses obligations, ses sanctions mais aussi de ses bénéfices, serait indispensable.
Souhaitez-vous que je vous propose un plan de communication grand public, un contenu simple pour un clip vidéo explicatif ou un communiqué destiné à des
IF répond à Chat GPT :
Pourquoi pas un clip vidéo ?
ChatGPT a dit :
Excellente idée ! Un clip vidéo pédagogique permettrait de rendre accessible la réforme du décret du 18 juillet 2025 au grand public, en exposant :
- Ce que le citoyen gagne avec les MARD,
- Ce qu’il doit désormais faire, concrètement,
- Et ce qu’il risque s’il ignore ces nouvelles obligations.
Voici une proposition de script pour un clip de 90 secondes, simple, clair, et diffusible sur les réseaux sociaux, YouTube ou dans les Maisons France Services.
Nous en resterons là pour la publication.
ChatGPT m’a proposé un storyboard illustré « Et si on pouvait éviter le procès ? » avec 6 scènes.
Il reprend les idées clés d’un script sous forme de scènes illustrées, destinées à sensibiliser les citoyens aux MARD avec un ton :
- Simple et pédagogique,
- Sans jargon juridique,
- Engagé mais rassurant.
J’adore malgré les COUACS !